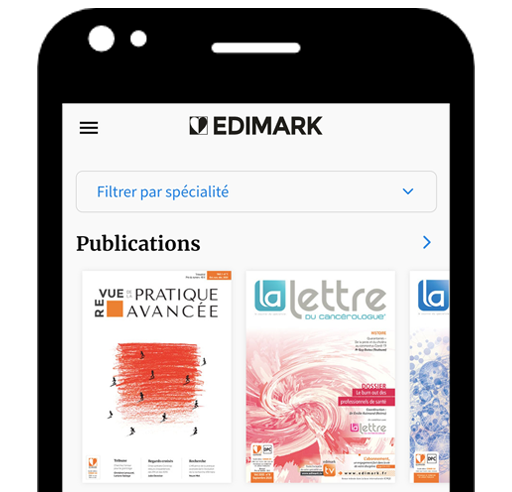Mise au point
Virus de l'Hépatite C – Test and treat : le nouveau paradigme de l'hépatite C en France ?
- Alexia a appris qu'elle avait une hépatite C en 1999, lors d'un passage en prison. Elle ne sait pas si sa maladie est active ou non. Elle est traitée par méthadone depuis 10 ans en CSAPA. Régulièrement, l'infirmière qui lui distribue son médicament lui rappelle de prendre en charge son hépatite C et lui prend rendez-vous en hépatologie à l'hôpital, mais jamais Alexia n'y est allée.
En 2010, le rapport d'expertise collective de l'Inserm intitulé Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues (1) préconisait (déjà) la prise en charge somatique des usagers de drogues sur un seul site, c'est-à-dire un fonctionnment “tout en un”. Petit à petit, des consultations avancées ont été mises en place dans des CSAPA, permettant la prise en charge et le traitement d'un grand nombre d'usagers. Depuis leur instauration (2), le dépistage et le traitement des hépatites virales font partie intégrante des missions des CSAPA. En 2016, une enquête de terrain (3) a…
L’accès à la totalité de l’article est protégé
Vous possédez déjà un compte Edimark ?
Merci de saisir votre e-mail et votre mot de passe.
Identifiant ou mot de passe oublié
Besoin d'aide ?
Créer un compte
Liens d'intérêt
A.J. Rémy déclare avoir des liens d’intérêts avec AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead et MSD.
Identifiant / Mot de passe oublié
Vous avez oublié votre mot de passe ?
Vous avez oublié votre identifiant ?
Consultez notre FAQ sur les problèmes de connexion ou contactez-nous.Vous ne possédez pas de compte Edimark ?
Inscrivez-vous gratuitementPour accéder aux contenus publiés sur Edimark.fr vous devez posséder un compte et vous identifier au moyen d’un email et d’un mot de passe. L’email est celui que vous avez renseigné lors de votre inscription ou de votre abonnement à l’une de nos publications. Si toutefois vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, veuillez nous contacter en cliquant ici.