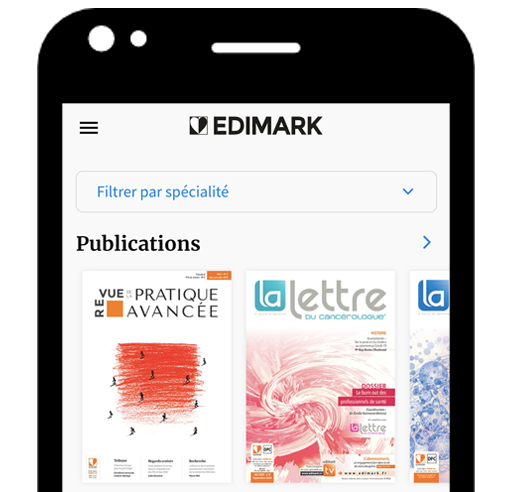Mise au point
Pharmacoépidémiologie dans l'asthme
- La sécurité et l'efficacité des traitements sont étudiées dans des études interventionnelles de bonne validité interne (essais cliniques randomisés, à haut niveau de preuve), qui ne prédisent cependant pas complètement les effets observés en conditions réelles d'utilisation (exemple : adhésion).
- À la suite de plusieurs alertes de sécurité médicamenteuse (β2-mimétiques), et depuis la mise à disposition des données digitales (les “big data” en santé), un nombre croissant d'études observationnelles s'intéressent aux caractéristiques des professionnels de la santé et des patients initiant les nouveaux traitements, aux modes d'utilisation, et aux effets de ces traitements, tels qu'ils sont observés dans la vraie vie.
- Lorsqu'elles sont bien conduites (selon les recommandations des bonnes pratiques de pharmacoépidémiologie), les études de pharmacoépidémiologie produisent des résultats robustes, qui permettent de mieux définir la place des traitements, de réduire les risques d'effets indésirables, et d'optimiser l'efficacité en conditions réelles d'utilisation.
Traditionnellement, il n'est pas simple d'avoir une vision exhaustive du parcours de soins des patients asthmatiques, pour plusieurs raisons : L'asthme atteint surtout les enfants et les adultes jeunes, c'est-à-dire des populations actives et mobiles, qui pratiquent parfois le nomadisme médical ou pharmaceutique. Outre que l'asthme est souvent considéré – à tort – comme une maladie bénigne, c'est une maladie parfois difficile à identifier et à prendre en charge, du fait de la difficulté du diagnostic (une étude récente estime que plus de 20 % des asthmes ne sont pas diagnostiqués et que plus de…
L’accès à la totalité de l’article est protégé
Vous possédez déjà un compte Edimark ?
Merci de saisir votre e-mail et votre mot de passe.
Identifiant ou mot de passe oublié
Besoin d'aide ?
Créer un compte
Liens d'intérêt
M. Belhassen déclare être directrice de la société PELyon, bureau d’études spécialisé en pharmacoépidémiologie.
E. Van Ganse déclare être référent scientifique de la société PELyon.
Identifiant / Mot de passe oublié
Vous avez oublié votre mot de passe ?
Vous avez oublié votre identifiant ?
Consultez notre FAQ sur les problèmes de connexion ou contactez-nous.Vous ne possédez pas de compte Edimark ?
Inscrivez-vous gratuitementPour accéder aux contenus publiés sur Edimark.fr vous devez posséder un compte et vous identifier au moyen d’un email et d’un mot de passe. L’email est celui que vous avez renseigné lors de votre inscription ou de votre abonnement à l’une de nos publications. Si toutefois vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, veuillez nous contacter en cliquant ici.