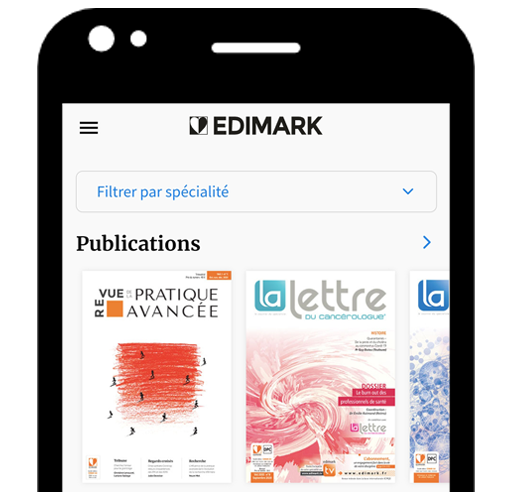Le lécanémab est un anticorps monoclonal qui cible les agrégats de protéine amyloïde dans le cerveau, dans la maladie d’Alzheimer. Son mode d’action repose sur la capacité à réduire la charge amyloïde, dans l’hypothèse de la fameuse cascade, ce qui pourrait ralentir la progression de la maladie. Les études cliniques ont montré des résultats prometteurs, qui passent notamment par une diminution significative de l’aggravation des symptômes chez les patients en phase précoce. On ne reviendra pas ici sur la longue saga des anticorps monoclonaux dans cette maladie ; le bénéfice du lécanémab, même s’il paraît modeste, peut sur une longue période de prise en charge faire une différence significative. Lorsque l’effet est modéré, il est d’autant plus important de commencer le traitement tôt. Cependant, l’utilisation du lécanémab ne peut se faire sans une organisation rigoureuse des soins. Le produit nécessite des administrations fréquentes, et de potentielles réactions immunes centrales peuvent survenir, ce qui impose une surveillance clinique et radiologique rigoureuse.
Il est impératif de structurer une filière de soins qui ne repose pas uniquement sur les hôpitaux de jour (HDJ) des centres hospitaliers universitaires. La prise en charge du traitement nécessite un maillage territorial solide, reliant les neurologues libéraux avec activité hospitalière, les centres hospitaliers généraux (CHG) et les centres experts/centres mémoire ressources recherche (CMRR). En effet, les CMRR seuls pourront difficilement répondre à toutes les demandes, les HDJ étant d’ores et déjà très sollicités et la mise à disposition d’un tel produit entraînant le plus probablement une augmentation des explorations des troubles cognitifs en soins primaires, et par conséquent, une projection de patients éligibles certainement supérieure à l’estimation qui en est faite aujourd’hui avec les pratiques existantes.
Les structures locales devront être équipées d’HDJ, de services d’IRM avec neuroradiologues afin d’assurer un suivi adéquat des patients, mais elles devront aussi être capables de répondre aux besoins diagnostiques avec en particulier les biomarqueurs (liquide cérébrospinal actuellement, sanguins avec pTau217 ?) comme premiers points de relais depuis la médecine générale. Ces équipes travailleront en étroite collaboration avec les CMRR pour garantir une continuité des soins et un suivi rigoureux des traitements. La synergie entre ces différents acteurs est essentielle pour optimiser le bon usage du lécanémab et assurer un accès aux soins équitable sur le plan géographique, avec un parcours patient fluide. Il existe des discussions pour envisager un accès précoce dès cette année, ce qui pourrait, le cas échéant, permettre de roder les centres et les circuits à très court terme.
L’Association des neurologues libéraux de langue française jouera un rôle crucial dans cette démarche. Elle est à même, par sa représentativité, d’informer les professionnels concernés et d’aider à identifier les correspondants qui répondront au cahier des charges établi pour la mise en œuvre du traitement. Ainsi, une approche coordonnée entre tous les niveaux de soins est non seulement souhaitable, mais aussi nécessaire pour tirer pleinement parti des bénéfices offerts par le lécanémab. En renforçant cette collaboration, nous pouvons espérer améliorer significativement l’offre de soins et la qualité de vie des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.