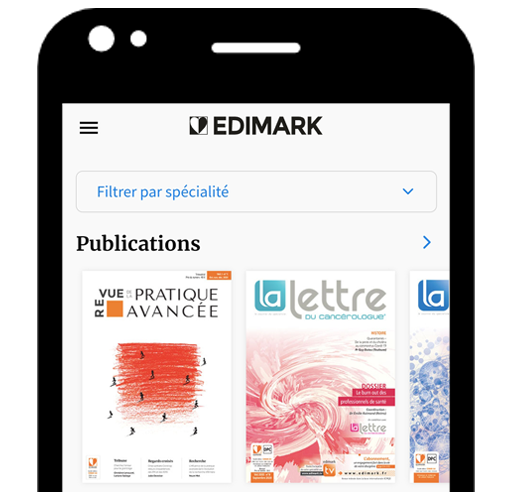À ce jour, les mécanismes physiopathologiques qui conduisent au diabète restent un sujet d’actualité et donnent lieu à d’intenses recherches. On relève deux caractéristiques principales associées au diabète de type 2 (DT2), représentées par l’insulinorésistance et une réduction de la sécrétion quantitative et qualitative d’insuline causée par des défauts fonctionnels des cellules β. Ces anomalies métaboliques aboutissent à une hyperglycémie chronique.
Lorsqu’un individu absorbe des aliments, l’élévation de la glycémie induit la sécrétion d’insuline par le pancréas, ayant pour effet une captation du glucose par les cellules, et un stockage du glucose dans le foie, les muscles et le tissu adipeux. Chez les personnes en surpoids, et notamment lorsqu’il existe un excès de graisses abdominales, ces effets de l’insuline sont altérés et on parle d’insulinorésistance. Celle-ci provoque dans un premier temps une hyperinsulinémie compensatoire qui sert à maintenir un niveau normal de glucose. À plus long terme, les cellules β ne fonctionnent plus correctement, et un diabète apparaît.
Ces défauts métaboliques nous invitent donc à nous interroger sur le rôle du mode de vie des patients, et d’abord sur l’influence de leur alimentation. Dans ce dossier thématique, le Dr Jean-Michel Lecerf, clinicien et directeur du service nutrition et activité physique de l’institut Pasteur de Lille, nous éclaire sur les rôles de la nutrition dans la résistance à l’insuline. Il donne son point de vue sur un rôle potentiel direct des lipides et des glucides, mais surtout, il révèle le rôle déterminant de l’obésité et de l’adiposité abdominale. Il montre également le lien avec une inflammation chronique de bas grade, une dysbiose et un stress oxydant. La compréhension fine de ces mécanismes permettra de parfaire les conseils nutritionnels apportés aux patients pour une meilleure santé.
Le Dr Cédric Moro, directeur de recherche à l’Inserm à Toulouse, nous présente ensuite les mécanismes de l’insulinorésistance musculaire. Il montre notamment les effets d’un stockage ectopique inapproprié de lipides dans le muscle. Cet événement implique des médiateurs lipotoxiques qui inhibent la voie de signalisation de l’insuline. Ces données sont particulièrement intéressantes pour envisager la découverte de nouvelles cibles insulinosensibilisantes dans un avenir proche.
Par ailleurs, lorsque l’on évoque l’insulinorésistance, on pense tout de suite aux tissus cibles de l’insuline, le foie, le muscle et le tissu adipeux. Les données récentes décrites par les Prs Christophe Magnan (université de Paris) et Hervé Le Stunff de l’institut des neurosciences Paris-Saclay suggèrent que cette vision est un peu réductrice. En effet, ils montrent que les céramides produits en excès dans l’hypothalamus peuvent conduire à une résistance centrale à l’insuline, et finalement à des anomalies de l’homéostasie glucidique. L’implication de tels mécanismes dans l’apparition d’un DT2 est discutée dans leur article.
Le Dr Camille Vatier et le Pr Corinne Vigouroux, qui exercent au Centre de référence des pathologies rares de l’insulinosécrétion et de l’insulinosensibilité (Centre de référence coordonnateur des pathologies rares de l’insulinosécrétion et de l’insulinosensibilité ou PRISIS) à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, nous font part de leur approche des syndromes de l’insulinorésistance extrême. Ce sont des maladies très rares, associées à des défauts de la signalisation de l’insuline ou bien des maladies du tissu adipeux. Les autrices présentent les examens cliniques qui permettront de savoir s’il faut ou non procéder à une analyse génétique. De plus, elles indiquent comment le réseau national des maladies rares PRISIS peut aider les thérapeutes dans leur démarche de soins, et ainsi améliorer le bien-être des patients.
Enfin, les effets indésirables des médicaments sont évalués grâce à la pharmacovigilance. Il est bien établi que certains de ces médicaments peuvent déclencher, voire aggraver, l’insulinorésistance. Le Pr Benjamin Bouillet, endocrinologue à Dijon, illustre cette question en s’intéressant aux traitements du cancer. Il montre ainsi que l’utilisation d’inhibiteurs de mTOR, d’inhibiteurs de tyrosine kinase ainsi que le recours à l’alpélisib peuvent conduire à une insulinorésistance, entraînant une hyperglycémie et un diabète. Le Pr Bouillet détaille dans son article les mécanismes physiopathologiques et les données épidémiologiques, puis propose une prise en charge des complications métaboliques dues à certains de ces médicaments. Ces considérations nous semblent particulièrement importantes pour un meilleur dépistage et une meilleure prise en charge des patients.
Ce numéro thématique nous donne ainsi l’occasion de découvrir certains volets de l’insulinorésistance qui sont peu abordés habituellement, et nous espérons qu’ils contribueront à une meilleure connaissance et à un meilleur traitement du DT2.■