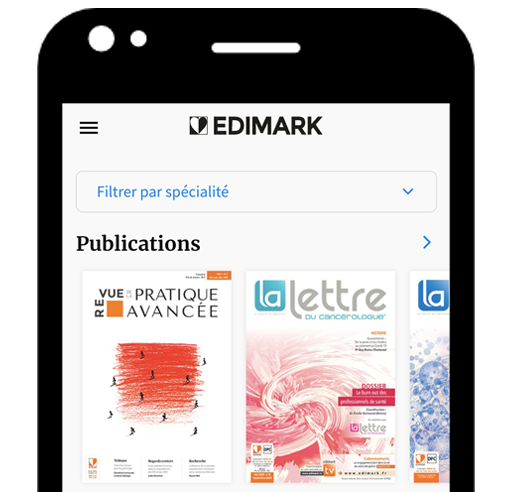Les bénéfices du traitement de l’hypertension artérielle (HTA), la maladie la plus fréquente au monde, sont reconnus dans le monde entier.
L’hypertension artérielle est à l’origine de 10 millions de décès par an dans le monde. Les bénéfices du contrôle tensionnel, c’est-à-dire le fait de ramener les chiffres de tension à la normale, sont démontrés depuis bien longtemps : réduction à court terme du risque de complications graves comme l’encéphalopathie hypertensive, réduction à long terme du risque de démence et d’accidents vasculaires cérébraux, d’insuffisance cardiaque, d’infarctus du myocarde et de décès cardiovasculaires, et du risque de dialyse chez certains patients insuffisants rénaux. Ceci est constaté sous toutes les latitudes et dans tous les pays.
Quelle est la situation en France ?
“Il faut toujours dire ce que l’on voit ; surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit” [1]. À présent que les résultats de plusieurs études françaises récentes ont été dévoilés, que voit-on ? Les résultats sont concordants et effrayants : le roi est nu.
Parmi les 17 millions d’hypertendus, 1 sur 2 ne se sait pas hypertendu, 1 sur 2 seulement est traité par des médicaments. Parmi ces derniers, 1 sur 2 seulement a une tension normale. Nous faisons moins bien que par le passé : le contrôle tensionnel est de moins en moins souvent atteint, en particulier chez les femmes. Parallèlement, le taux de décès cardiovasculaires dus à l’HTA a augmenté de 2015 à 2019. Nous faisons également moins bien que les autres pays : entre 65 et 80 % des patients hypertendus se savent hypertendus aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, au Portugal et en Angleterre, et leur contrôle tensionnel est atteint dans 70 à 80 % des cas. La même constatation a été faite chez les patients hypertendus qui ont une insuffisance rénale chronique par comparaison avec les autres pays d’Europe. Le taux de complications graves comme l’encéphalopathie hypertensive, responsable de démence à court terme, est plus important qu’aux États-Unis. Le taux d’inertie thérapeutique (absence d’intensification du traitement par le médecin malgré des chiffres de tension manifestement trop élevés) est plus important que chez nos voisins. Tous les indicateurs disponibles démontrent notre déclassement médical, par rapport à notre passé comme par rapport aux autres pays.
Comment ce désastre a-t-il pu se produire ?
Ce désastre est tout sauf une surprise : il a été annoncé depuis plus de 10 ans par des associations de patients et des sociétés savantes, en vain. Le décret n°2011-726 du 24 juin 2011 a retiré “l’HTA sévère (ALD 12)” de la liste des Affections de longue durée (ALD). Cette décision a été prise contre l’avis de la Haute Autorité de santé qui avait indiqué que “la suppression isolée de l’ALD 12 ne permettait pas d’œuvrer à l’homogénéité de prise en charge des situations cliniques associées à la prise en compte d’un risque cardiovasculaire élevé”. L’hypothèse était que les patients bénéficiant jusqu’alors de l’ALD 12 n’étaient probablement pas à haut risque : on voit à présent ce qu’il en est. L’existence d’un “reste à charge” pour les plus précaires est associée à une diminution de l’utilisation des traitements du risque vasculaire : le renoncement aux soins pour des raisons financières est démontré. L’Assurance maladie n’a eu pour but constant que de réduire le coût des prescriptions médicamenteuses, avec un “succès” bien malheureux pour nos patients : le coût des traitements du risque vasculaire a diminué entre 2015 et 2020, s’est-elle félicitée ! Ce désastre a été construit méticuleusement, une sorte de “quoiqu’il en coûte” (entendons “quoi qu’il advienne aux patients”). On aurait pu s’attendre à une prise de conscience plus précoce, mais il n’en a rien été, au contraire. Aveuglés par les potentiels problèmes de conflits d’intérêts, certains ont oublié les intérêts légitimes de notre population. Ainsi, Le Monde a publié en 2014 un supplément Sciences et Médecine consacré aux prescriptions médicales inadaptées intitulé “Trop, c’est trop” avec comme “exemple emblématique” l’HTA. L’idée défendue était que l’industrie pharmaceutique influence les médecins et en particulier ceux qui édictent les recommandations pour la pratique, avec pour conséquence une surprescription inappropriée de médicaments contre la tension. Il faut dire et répéter avec force que cette suspicion est inacceptable pour les médecins, impliqués ou non dans les recommandations, qui ont choisi ce métier par vocation et qui l’ont montré notamment pendant l’épidémie de Covid-19. Cette défiance n’est d’ailleurs pas spécifique au domaine de l’HTA, elle concerne aussi la vaccination dans notre pays, comme cela avait été rapporté avant même le début de cette épidémie. D’autres médias ont pu tenir le même discours. L’influence possible de l’industrie pharmaceutique ne correspond pas à la réalité, ne serait-ce que parce que les médicaments antihypertenseurs sont pratiquement tous génériques depuis longtemps. Cependant, le fait de génériquer les médicaments antihypertenseurs a mécaniquement abouti au désengagement de l’industrie pharmaceutique dans ce domaine. Nos patients y ont-ils gagné ? L’accès aux innovations thérapeutiques, y compris dans le domaine de l’HTA, souvent tardif en France, ne permet pas toujours – et parfois pas du tout – à nos patients d’en bénéficier aussi rapidement que ceux issus d’autres pays d’Europe, d’Amérique du Nord, voire d’Afrique du Nord. On peut critiquer les médecins, les experts, les industriels, les sociétés savantes et les recommandations internationales, mais les faits sont têtus : les conséquences de ce “quoiqu’il en coûte” pour les patients ont été catastrophiques dans le domaine de l’HTA, la maladie la plus fréquente en France.
Que faire ?
En l’état, peut-on s’attendre à une amélioration spectaculaire de notre performance dans ce domaine ? Probablement pas, et pas simplement à cause de la désertification médicale. L’annexe au projet de loi de finances pour 2025 qui vient d’être rendue publique n’annonce aucune action en faveur de la lutte contre l’HTA. Une étude récente montre que nos internes, ceux qui vont nous soigner demain, reconnaissent avoir de plus et plus de difficultés à gérer les problèmes simples liés à l’HTA. À chaque étage de la prévention et de la santé publique, les données françaises publiées dans le domaine de l’HTA sont donc terribles. Le roi est effectivement nu. Ces données doivent être analysées et donner lieu à une prise de conscience collective des autorités et de l’ensemble des professionnels de santé. L’amélioration du contrôle tensionnel observée dans les pays cités ne doit rien au hasard : elle est la conséquence de modifications de politiques de santé. Des propositions ont été synthétisées récemment dans un livre blanc élaboré par la Société française d’hypertension artérielle. Elles reposent sur la formation initiale et continue, l’évaluation des pratiques et l’innovation : ici comme ailleurs, il n’y aura pas de baguette magique. Ce livre blanc détaille les mesures concrètes pour améliorer l’enseignement, la prévention, le dépistage, la prise en charge, la recherche et l’évaluation en HTA. “Vaste programme” bien entendu, mais avons-nous le choix ? Chacun de ces éléments doit être décliné à la fois sur le court terme et sur le long terme pour lutter contre cette faillite médicale. Au quotidien, le vrai défi pour nous médecins est d’obtenir une alliance thérapeutique avec nos patients : cette alliance peut aussi être réalisée entre les soignants, y compris les infirmières en pratique avancée et les pharmaciens, et les autorités de santé car in fine, l’important est de mieux soigner, pas de prescrire plus ou de prescrire moins.■