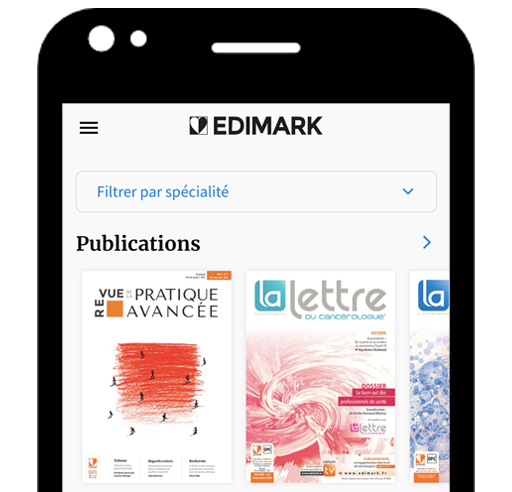Que de chemin parcouru depuis la publication fin 1989 de la déclaration de Saint-Vincent, à l’issue d’une conférence internationale exceptionnelle ayant réuni, sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Fédération internationale du diabète (IDF), des experts internationaux, des représentants de l’ensemble des gouvernements européens et les principales associations de patients du vieux continent. Déjà conscients des enjeux majeurs en termes de santé publique, les signataires de cette déclaration convenaient du caractère d’urgence et de la nécessité de plans d’action communs afin de réduire les conséquences désastreuses du diabète et, plus spécifiquement, la survenue des complications micro- et macrovasculaires [1].
Cet objectif prioritaire reste malheureusement d’actualité en 2025 et mérite plus que jamais l’attention de notre communauté médicale, mais également celle des décideurs politiques, compte tenu de l’impact croissant du diabète et de ses complications sur nos systèmes de santé. Confrontées à l’amélioration de l’espérance de vie des personnes vivant avec un diabète, nos sociétés doivent en particulier faire face à la progression de la prévalence des pathologies cardiovasculaires, incluant la maladie athéromateuse et l’insuffisance cardiaque, et de la maladie rénale chronique dans ce contexte dysmétabolique. Il était donc parfaitement légitime et utile de proposer une vision actualisée du risque cardiorénal associé au diabète dans ce numéro.
Si la situation épidémiologique reste à ce jour très préoccupante, notamment dans les territoires ultramarins, comme l’illustre l’excellente synthèse des résultats de l’étude Entred 3 proposée par S. Fosse-Edorh et al. (Santé publique France), nous pouvons tout de même nous réjouir des progrès considérables réalisés au cours des trois dernières décennies. De l’importance d’un contrôle glycémique optimal s’intégrant dans une approche multifactorielle, ciblant l’ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire, à la protection cardiorénale spécifiquement conférée par les nouvelles classes pharmacologiques, les preuves apportées par les grands essais randomisés contrôlés ont véritablement révolutionné nos standards de prise en charge. Comme nous le rappelle T. Vidal-Trécan (hôpital Lariboisière, AP-HP), les dernières recommandations consacrées à la stratégie thérapeutique du diabète de type 2 désignent d’ailleurs la protection des organes cibles comme étant un élément décisionnel prioritaire. L’existence ou un risque élevé de développer une maladie rénale chronique, une maladie athéromateuse avérée ou une insuffisance cardiaque doivent désormais guider nos choix thérapeutiques, parallèlement au maintien d’un niveau de contrôle glycémique adapté à chaque patient.
Pour une prise en charge individualisée, il est bien entendu primordial de considérer les facteurs susceptibles d’influencer le risque cardiovasculaire des personnes vivant avec un diabète, et tout particulièrement le sexe des individus. En effet, B. Tramunt (CHU de Toulouse) apporte dans sa revue de la littérature tous les éléments permettant d’affirmer que les femmes et les hommes ne sont pas égaux face à l’impact délétère du diabète sur le plan cardiovasculaire. Par ailleurs, la prédiction et la prise en charge du risque cardiovasculaire de nos patients vivant avec un diabète de type 1 sont bien moins codifiées et donc plus difficiles à appréhender en pratique courante. L. Salle (CHU de Limoges) propose de nous éclairer sur les spécificités du risque cardiovasculaire dans ce contexte spécifique du diabète auto-immun.
Enfin, il ne fait aucun doute que l’organisation actuelle du parcours de soins des patients atteints de diabète ne permet pas d’instaurer les conditions d’une protection cardiorénale optimale. Ce constat a récemment conduit à la mise en place du programme européen JACARDI (Joint Action on CARdiovascular diseases and DIabetes), dont l’ambition est de favoriser des initiatives de santé publique dans le domaine des maladies cardiovasculaires et du diabète [2]. En avant-première, l’équipe coordonnée par S. Hadjadj (CHU de Nantes) vous présente l’étude ITINERANCE, un projet visant à réduire la survenue d’événements cardiovasculaires et rénaux majeurs chez des personnes atteintes de diabète et de maladie rénale chronique, en s’appuyant sur les laboratoires de biologie médicale.
Je vous souhaite donc une excellente lecture de ce dossier, en espérant que nos experts renforceront votre perception de la nécessité d’une approche coordonnée pour offrir à vos patients un niveau optimal de protection cardiovasculaire et rénale. Une approche coordonnée qui impose que tous les acteurs du parcours de soins portent une vision cohérente et concertée des démarches d’évaluation des risques, des objectifs individualisés et des choix thérapeutiques. Médecins généralistes, diabétologues, cardiologues ou néphrologues, n’oublions pas que pour protéger efficacement nos patients atteints de diabète, l’union fait la force !■