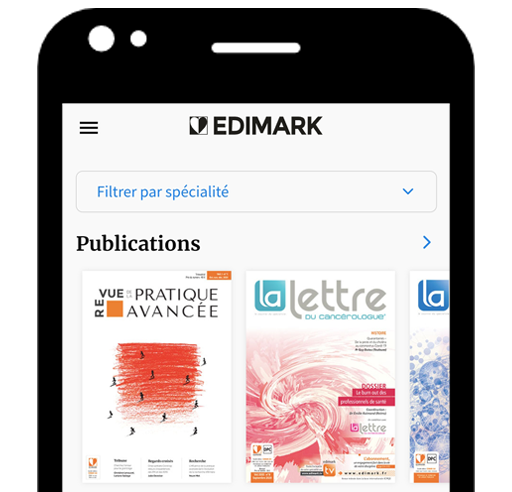Lors du congrès de l’American College of Cardiology au mois de mars à Chicago, les résultats de l’étude ALLEPRE ont été présentés lors d’une des sessions de hotlines. Il s’agit d’une étude d’intervention infirmière pour la prévention secondaire après syndrome coronarien aigu, menée en Italie, dans 7 hôpitaux de la région d’Émilie‑Romagne, autour de Parme.
Plus de 250 infirmières prenant en charge des syndromes coronaires aigus ont été formées à l’accompagnement et au suivi des patients en post-infarctus. Cet apprentissage comportait une formation pluridisciplinaire à l’éducation du patient, aux changements de mode de vie (sevrage tabagique, reprise et poursuite d’une activité physique régulière, perte de poids chez les patients en surpoids ou obèses, alimentation de type méditerranéen) ainsi qu’à l’importance du suivi et de la titration des médicaments de prévention secondaire : médicaments antiagrégants plaquettaires et le cas échéant anticoagulants, médicaments hypolipidémiants, traitements antihypertenseurs, traitements du diabète.
À l’issue de cette formation, les infirmières étaient certifiées. Elles ont ensuite pu participer à un essai randomisé contrôlé qui a inclus 2 057 patients hospitalisés pour syndrome coronarien aigu (STEMI, NSTEMI ou angor instable). Les patients étaient tirés au sort entre la prise en charge habituelle et un programme de prévention secondaire coordonné par les infirmières et débuté avant la sortie de l’hôpital. Ce programme comportait 9 sessions individuelles d’éducation thérapeutique avec une infirmière certifiée, la première réalisée avant même la sortie de l’hôpital et les 8 autres réparties sur les 4 ans suivants. Pendant ces sessions, les infirmières évaluaient le profil de risque de chaque sujet, son mode de vie, et son adhésion aux traitements, en utilisant un formulaire standardisé. Le premier niveau d’intervention était un conseil personnalisé sur la prise en charge des facteurs de risque et le mode de vie. Un second niveau d’intervention permettait aux infirmières d’activer, de façon autonome, un réseau pluridisciplinaire de spécialistes médicaux afin d’optimiser le traitement des facteurs de risque et d’offrir le cas échéant un soutien psychologique. Le critère principal de jugement de l’essai était un critère composite : mortalité liée à une maladie cardiovasculaire, infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral. Le suivi maximal des patients dans cette étude était de 7 ans. À la fin de l’essai, il y avait une réduction statistiquement significative du risque d’événement cardiovasculaire de 30 % en termes relatifs, en faveur du bras “éducation thérapeutique” avec un taux d’événements de 22,6 % dans le bras contrôle contre 16,2 % dans le bras “éducation thérapeutique” (p < 0,001) (figure). Le bénéfice apparaissait dès les premiers mois de suivi et croissait régulièrement avec le temps. À la fin du suivi, il n’y avait pas de différence entre les groupes en termes de sevrage tabagique, de taux de LDL cholestérol, de niveau de pression artérielle systolique ou de taux d’hémoglobine glyquée. En revanche, l’indice de masse corporelle (IMC), le niveau moyen d’activité physique et surtout l’adhésion au traitement étaient statistiquement significativement meilleurs dans le bras “éducation thérapeutique”.
Cet essai randomisé démontre qu’un programme d’éducation thérapeutique entièrement géré par des infirmières a un impact majeur sur le risque d’événements cliniques cardiovasculaires dans une population souffrant d’un syndrome coronarien aigu. Cet impact est obtenu alors que les niveaux de cholestérol, de pression artérielle, d’hémoglobine glyquée et même de sevrage tabagique ne sont pas significativement différents entre les groupes. Cela souligne l’importance des modifications du mode de vie (notamment l’activité physique) et certainement l’importance capitale d’une meilleure observance du traitement : celle-ci était augmentée d’environ 50 % dans le bras ayant eu l’intervention “éducation thérapeutique”, ce qui est considérable, et rend probablement compte de la plus grande partie du bénéfice clinique observé.
De multiples études préalables ont déjà montré combien l’observance thérapeutique à long terme est médiocre en prévention cardiovasculaire, car du point de vue des patients, il n’y a pas de manifestation tangible du bénéfice des traitements alors qu’ils sont confrontés à la contrainte de leur prise quotidienne, voire pluriquotidienne et de leurs éventuels effets indésirables. Ces choses sont parfaitement connues dans le domaine de l’insuffisance cardiaque et ont donné lieu depuis longtemps à la mise en place de programmes d’éducation thérapeutique dans l’insuffisance cardiaque chronique tant en France qu’à l’étranger. Elles sont moins connues en post-infarctus et probablement négligées. On peut se demander si l’amélioration spectaculaire du pronostic hospitalier de l’infarctus du myocarde aigu dans les dernières décennies n’a pas conduit à un excès d’optimisme des cliniciens, qui se sont désintéressés de la mortalité secondaire en particulier liée aux récidives et aux complications de l’infarctus du myocarde. À cet égard, l’essai ALLEPRE constitue une démonstration éclatante de l’intérêt et du bénéfice clinique majeur de ce type d’intervention. Après cette présentation retentissante, nous attendons la publication des résultats in extenso de l’essai. Bien qu’aucune donnée médicoéconomique n’ait encore été présentée, il serait très étonnant qu’une intervention de type éducation thérapeutique par des infirmières ne s’avère pas “coût-efficace” si elle réduit la morbimortalité de 30 %. Enfin, il faut souligner l’immense mérite de l’équipe d’investigateurs d’avoir mis en œuvre une intervention purement infirmière. Là encore, l’ampleur du bénéfice observé démontre que la recherche paramédicale n’est pas un “appendice accessoire” de la recherche clinique, mais qu’elle a au contraire une place éminente et centrale dans une prise en charge complète des patients et de leurs besoins. Le bénéfice observé est plus important que celui de beaucoup des interventions médicamenteuses de prévention secondaire, y compris les plus récentes et les plus coûteuses. C’est une leçon majeure à méditer… Il y a beaucoup à gagner, tant pour les patients que pour les systèmes de santé, à impliquer plus fortement les infirmières dans la recherche et la prévention !