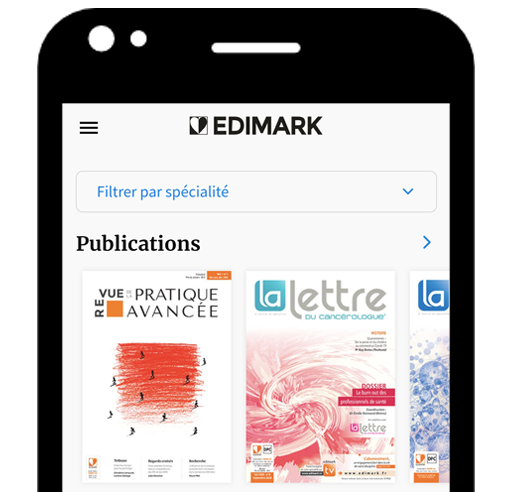C’est dans les années 2000 que la préoccupation environnementale est devenue un sujet d’intérêt en neurologie. Le Club de neurologie de l’environnement, soutenu par les présidents Maurice Collard puis Lucien Rumbach [1], ainsi que par certains de nos partenaires de l’industrie pharmaceutique, a permis de rassembler des groupes et des personnalités qui ne se côtoyaient pas. Le constat était évident, les enjeux multiples. Bien qu’il soit connu, le rôle causal – parfois déterminant – de l’environnement dans la survenue de maladies neurologiques n’était pas encore envisagé per se. L’absence d’information et de formation de notre communauté ne permettait pas de répondre aux interrogations de nos patients qui reliaient leur maladie à des causes environnementales, attitude favorisée par une préoccupation sociétale naissante [2]. De fait, nous nous inscrivions dans une histoire que nous avons, par la suite, redécouverte. En effet, la neurologie environnementale fait appel à la tradition hippocratique et au célèbre traité Airs, eaux, lieux, dans son approche des milieux et des agents. Cette discipline est redevable à la toxicologie et à la neuro-épidémiologie, mais également à la santé publique. Elle s’est ouverte aux sciences de la terre et de la vie, pour comprendre la notion d’environnement. Pour définir celle-ci, la neurologie environnementale a fait sienne la brillante définition d’Albert Einstein : “The environment is everything that isn’t me” [3]. Rappelons le rôle majeur de Jean-François Mattei qui proposa dès 1995 de développer la médecine environnementale dans son rapport à l’Assemblée nationale, un apport capital trop souvent ignoré. En 2007, grâce à nos amis Américains, la Fédération mondiale de neurologie a créé un groupe de travail dédié
à la neurologie environnementale (Environmental Neurology Specialty Group, ENSG) et le Journal of the Neurological Sciences y consacra un numéro spécial [4, 5]. En 2019, la Revue Neurologique fera de même [6].
Avec la médiatisation de l’urgence climatique, l’environnement s’impose définitivement. Que de chemin parcouru depuis 25 ans ! Mais, qu’est-ce qui nous attend ? L’augmentation de l’incidence des maladies non contagieuses (non-communicable diseases), documentée depuis plus de 30 ans, qualifiée de pandémie, ou épidémie mondiale, va se poursuivre avec un gain de la prévalence de +17 % par an pour les 10 prochaines années [7]. Elle concerne aussi les maladies neurologiques. D’ici 2040, le nombre de patients souffrant de la maladie de Parkinson devrait doubler et atteindre 12 millions à travers le monde [8]. Les États-Unis ont pris la mesure du problème, et le président Biden a signé, en juillet 2024, le National Plan to End Parkinson’s Act [9]. Les projections de prévalence concernant la maladie d’Alzheimer sont tout aussi alarmantes. En 2018, en France, 1 million de personnes présentaient un syndrome démentiel selon les estimations officielles. Une augmentation de 80 % est prévue pour 2050. Au niveau mondial, un doublement est prévu avec 80 millions de patients déments en 2040 [10]. La commission conjointe Lancet-Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit, au niveau de la planète, une augmentation de 50 % des décès par accident vasculaire cérébral (AVC) entre 2020 et 2050, et de 30 % des DALY (disability-adjusted life years) [11]. Les scénarios concernant la prévalence de la SEP suggèrent aussi une augmentation de 75 à 85 % en Allemagne, en accord avec d’autres études européennes [12].
Ces projections statistiques amènent à nous interroger. Est-ce suffisant d’attribuer l’augmentation de la prévalence des maladies neurodégénératives au vieillissement des populations, comme le fait E.R. Dorsey [8] ? Les changements de notre environnement ne seraient-ils pas aussi en cause ? C’est en tout cas ce que montrent l’épidémiologie génétique et l’épigénétique et ce que sous-tend la notion de maladie complexe. La part non génétique des maladies est prédominante, comme le montre indirectement l’épidémiologie génétique. Les mécanismes épigénétiques illustrent la complexité des interactions entre susceptibilité génétique et facteurs d’environnement. C’est là que les approches proposées par la neurologie environnementale devraient prendre une place déterminante : étudier les causes environnementales pour améliorer la prévention. La prise en compte des facteurs de risque (évitables et/ou modifiables) et la prévention primaire sont devenues un enjeu majeur de santé publique, concernant l’ensemble des professionnels de santé comme le soulignent les chercheurs du Global Burden of Diseases (GBD) [13].
La modification de la classification internationale des maladies par l’OMS a évidemment facilité cet objectif. En effet, en 2018, l’OMS a enfin intégré les AVC aux affections neurologiques, en les dissociant des maladies cardiovasculaires [14]. Il faut souligner ici le travail remarquable de la Fédération mondiale de neurologie [15] et le rôle déterminant des données statistiques collectées et actualisées par le groupe du GBD [16]. Ce lobbying a ouvert la voie au concept de “santé du cerveau”, défendu par la World Brain Association [15] et adopté par de nombreuses organisations, dont bien sûr l’OMS. Celle-ci promeut ainsi la réalisation de plans nationaux par chaque État. L’université de Berne a même créé en 2024 un enseignement dédié à la santé du cerveau, ouvert à tous les professionnels de santé [17]. La santé du cerveau montre une réalité dont nous n’avions pas forcément conscience : les maladies du cerveau et du système nerveux touchent 1 individu sur 3 dans le monde, soit près de 3,4 milliards d’humains [18]. J’oserai ajouter une opinion personnelle : notre environnement y est pour quelque chose ! Saurons-nous faire face à ce défi, en tant que professionnels de santé ? Les décideurs des politiques de santé publique en prennent-ils la réelle mesure ?
Saluons l’initiative de La Lettre du Neurologue qui nous ouvre ses colonnes. Elle devrait faciliter les échanges, continuer à nous informer sur ces risques environnementaux et nous former à la prise en charge de nos patients. C’est pour eux que nous devons développer la prévention (sous toutes ses formes) et aussi la préparation à la gestion sanitaire des crises, dans ses aspects neurologiques. Et donc nous former, en attendant des formations adéquates.
Si cette obligation déontologique va de soi, nous ne pouvons pas ignorer la nécessité de nous associer à une démarche de santé publique en fournissant des données cliniques (cas-séries hospitalières) indispensables pour à la fois faire reconnaître d’éventuelles responsabilités juridiques, étayer les politiques de santé publique et proposer des axes de recherche. Favoriser la prévention primaire est l’affaire de la société, donc du politique, mais pas celle de l’individu. Ne nous trompons pas de responsable !
C’est cette stratégie que les promoteurs du concept de Brain Health suivent et développent auprès des décideurs. C’est un des objectifs majeurs de l’Académie européenne de neurologie : faire prendre conscience du fardeau des maladies neurologiques et psychiatriques aux décideurs économiques et politiques. Nous devrions nous en inspirer.