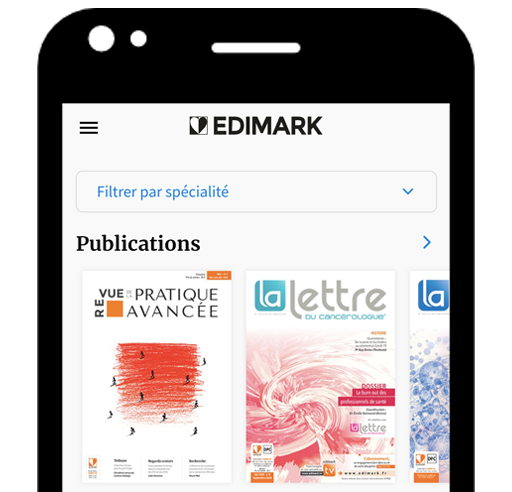Les troubles neurologiques fonctionnels (TNF), autrefois relégués aux marges de la médecine, connaissent aujourd’hui une renaissance scientifique, clinique et thérapeutique. Cette pathologie, souvent complexe, est pourtant encore stigmatisée. Se situant à la frontière entre neurologie et psychiatrie, les TNF touchent un nombre important de patients, et constituent une problématique médicale majeure, tant en France que dans le monde. Et pourtant les TNF divisent, les TNF dérangent.
D’une période d’intérêt scientifique au dédain de société
Historiquement, le TNF, appelé hystérie de conversion, a été au centre de l’intérêt scientifique des neurologues et neuropsychiatres. Jean-Martin Charcot, Sigmund Freud, les écrits sur le sujet ont été nombreux. Face aux théories psychanalytiques dominantes, ce trouble était perçu comme une maladie relevant de la psychologie, jusqu’à être complètement délaissé par les neurologues lors de l’avènement des approches dualistes portées par le développement des techniques d’imagerie exploratoire. La neurologie venait alors se concentrer sur les maladies dont les lésions étaient visibles, l’organique défiant le psychologique, comme une opposition qui se voulait parfaite. La preuve de la lésion devenait la marque légitimant une maladie.
Les troubles conversifs sont alors tombés dans l’antre des diagnostics d’exclusion, soulevant peu d’intérêt. Les patients se sont donc heurtés à des discours médicaux invalidant leur souffrance et leur handicap. Le “tout psychologique” est devenu un modèle explicatif, renforçant le sentiment d’abandon et d’incompréhension vécu par ces derniers. “C’est dans votre tête”, “Vous n’avez rien”, “Vous simulez”. Autant d’expressions qui ont fortement résonné face aux plaintes des patients, mais pourtant si vides de sens. Ce climat d’incompréhension est venu progressivement creuser le gouffre entre professionnels de santé et patients ayant des troubles conversifs. Entre défiance, méfiance et mépris, le trouble conversif n’était plus un sujet d’intérêt et d’innovation [1].
Des avancées significatives mais insuffisantes
Depuis les années 1990, une prise de conscience s’est cependant opérée, notamment en Écosse, marquée par le retour de l’intérêt clinique pour les troubles conversifs. Des critères diagnostiques positifs, comme le test de Hoover ou l’effet d’entraînement des tremblements, ont remplacé la logique diagnostique par exclusion. Les neurosciences fonctionnelles ont permis de révéler des fonctionnements cérébraux spécifiques présents chez les patients ayant des troubles conversifs.
Ces études ont ainsi pu apporter la preuve de l’absence de simulation de la part des patients. Des dysrégulations des systèmes d’alerte, au niveau limbique, prémoteur et intéroceptif, ont permis de mieux comprendre le vécu des patients, et de commencer à penser des approches thérapeutiques adaptées.
Ces avancées ont renforcé l’idée que ces troubles, bien qu’intrinsèquement neurologiques de par les altérations sensorimotrices, ne pouvaient être compris sans une perspective multidimensionnelle intégrant le biologique, le psychologique et le social [2]. Pour finir de lever la stigmatisation dont font l’objet ces patients, un travail consensuel de refonte des critères diagnostiques a permis de remplacer le terme de troubles conversifs par celui de troubles neurologiques fonctionnels en 2013 dans le DSM-5.
Une communauté scientifique croissante s’est alors développée, regroupant de plus en plus de pays autour des TNF. Ce regain d’intérêt se traduit d’ailleurs par le nombre croissant de publications scientifiques sur le sujet, passant de quelques dizaines dans les années 1990 à près de 3 000 en 2023.
Une société a été créée, la Functional Neurological Disorder Society, en 2019, animant tous les 2 ans des cycles de conférences internationales entre l’Europe et les États-Unis.
Le réseau TNF France, quant à lui, a été créé en 2018 pour tenter de réunir les professionnels de santé francophones autour des TNF, diffuser de l’information et de la formation auprès du grand public et des professionnels de santé concernés, développer la recherche sur les TNF, mais aussi des supports pour les patients et leurs proches. Ce même réseau s’est structuré au sein de la section Neuropsychiatrie de l’Association française de psychiatrie biologique et de neuropsychopharmacologie (AFPBN) par la suite, pour proposer des webinaires tous les ans sur les TNF, disponibles gratuitement, mais aussi une formation continue DPC pour les neurologues et les psychiatres sur les TNF.
Les patients au cœur du changement
Une transformation majeure réside dans l’implication croissante des patients dans la recherche et les soins. Des organisations comme FND Hope ont été développées pour sensibiliser à travers des plateformes numériques, donnant une voix à ceux qui étaient autrefois invisibles. Cette collaboration marque un changement de paradigme, passant d’une approche paternaliste à une véritable coconstruction du soin.
En France, le Collectif CAP TNF a été créé à l’initiative de groupes de patients en 2022 afin de centraliser les informations pour les patients en errance médicale, ou en recherche de contact sur ce sujet.
Vers une médecine de précision pour les TNF
Le futur des TNF s’annonce prometteur mais exigeant. L’enjeu du diagnostic précoce et d’une prise en charge pluridisciplinaire réactive émerge comme une priorité. Des recommandations de bonnes pratiques cliniques ont été rédigées en français en juin 2023 par la section Neuropsychiatrie de l’AFPBN, pour faciliter l’accès de tous les professionnels de santé francophones à l’information et la formation [3].
Le temps d’évaluation est devenu primordial dans ces soins, pour un diagnostic de qualité, un temps d’annonce codifié et impactant, et une coordination de soins pluridisciplinaires en vue d’un soin intégratif. De nombreux corps de métiers sont encore à former, des spécialistes pour le diagnostic aux professionnels intervenant dans la prise en charge (en rééducation de kinésithérapie, orthophonie, neuropsychologie, mais aussi psychothérapie). Des outils thérapeutiques se développent et se précisent, notamment des techniques de neuromodulation comme la stimulation magnétique transcrânienne ou la stimulation transcrânienne à courant continu.
Néanmoins, le risque d’un surdiagnostic ou d’une simplification excessive persiste, et nécessite une vigilance constante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les dichotomies historiques semblent s’estomper, et ce pour le plus grand bénéfice des patients.
Ces troubles sont une fenêtre unique sur l’interaction entre le corps et l’esprit. Leur prise en charge exige donc une approche pluridisciplinaire, humble et empathique, pour sortir de l’impasse médicale et travailler sur un terrain fertile, riche d’innovations et d’humanisme.