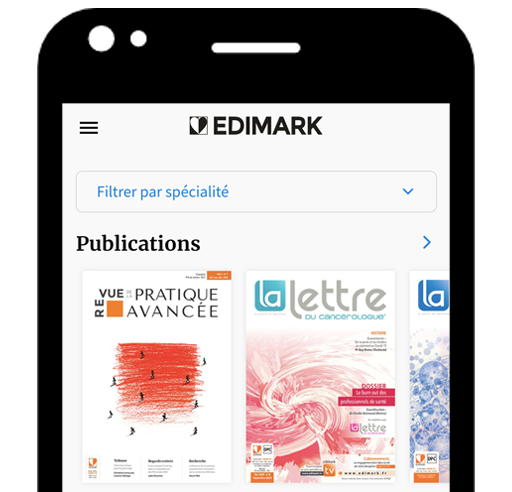La sclérose en plaques (SEP) est probablement la maladie neurologique dont le traitement a le plus évolué au cours des 30 dernières années. Depuis la mise sur le marché de l’interféron β-1b en 1996, plus de 20 traitements sont désormais commercialisés dans cette indication, même si tous ne sont pas accessibles en France. Grâce à ces thérapies, nous sommes capables de réduire, voire de supprimer, le risque de poussée chez la plupart des patients et d’abaisser le risque d’aggravation du handicap lié à la maladie à long terme. Cette efficacité thérapeutique est cependant tributaire du délai d’introduction du traitement, et il est bien établi qu’un traitement précoce apporte une meilleure protection. Les versions successives des critères diagnostiques de McDonald ont permis de raccourcir ce délai afin d’identifier de plus en plus précocement les patients susceptibles de recevoir un traitement de fond. Bien que l’amélioration de la sensibilité des critères du diagnostic ait pu se faire sans diminution de la spécificité, près de 20 % des patients recevant un diagnostic de SEP n’ont pas cette maladie, et le délai diagnostique est d’environ 2 ans après l’apparition des 1ers symptômes. Cela expose les patients à ne pas recevoir les traitements adaptés ou, au contraire, à encourir des risques thérapeutiques inutiles.
La communication des nouveaux critères diagnostiques par Xavier Montalban, lors du 40e congrès de l’ECTRIMS qui s’est tenu en septembre 2024 à Copenhague, était donc très attendue. Cette nouvelle version a été établie par un panel de 55 experts internationaux – cliniciens, radiologues, méthodologistes, épidémiologistes – provenant de 16 pays répartis sur tous les continents et respectant (presque) la parité hommes/femmes. Il s’agit probablement de la modification la plus importante des critères depuis la publication de la 1re version en 2001, avec l’adjonction de biomarqueurs spécifiques de la maladie comme le signe de la veine centrale ou la présence de lésions paramagnétiques en IRM. D’autres modifications sont proposées, parmi lesquelles on retiendra l’addition d’une 5e localisation avec l’atteinte du nerf optique, la disparition de la nécessité d’avoir une dissémination temporelle, l’utilisation du dosage des chaînes libres kappa à la place de la recherche de bandes oligoclonales (BOC) pour les centres ne disposant pas de ces techniques, l’unification des critères pour les formes à poussées et les formes primaires progressives, et, enfin, la reconnaissance des SEP asymptomatiques. En raison de la fréquence de l’atteinte du nerf optique chez les patients présentant une 1re poussée de la maladie, l’absence de cette localisation dans les critères paraissait surprenante, et les critères 2024 viennent remédier à ce manque. Toutefois, la caractérisation de cette atteinte par des techniques aussi diverses que les potentiels évoqués visuels (PEV), la tomographie par cohérence optique (OCT) ou l’IRM soulève des interrogations. Un travail de standardisation de ces techniques s’impose pour aider les cliniciens, pas toujours très à l’aise devant une différence relative de l’épaisseur interoculaire de la couche plexiforme interne des grains, par exemple, pour affirmer une atteinte du nerf optique ! L’abandon (partiel) du critère de dissémination temporelle peut heurter les cliniciens élevés dans la règle de la nécessaire association de la dissémination temporelle et spatiale pour le diagnostic de SEP, mais cet abandon était déjà à l’œuvre dans les critères 2017 avec son remplacement par la présence de BOC dans le liquide cérébrospinal (LCS). Cet abandon résulte de l’apport des données issues des études longitudinales IRM, en particulier chez les patients ayant un syndrome radiologiquement isolé (RIS), et qui démontre que les images de SEP n’apparaissent pas toutes en même temps et qu’une atteinte multifocale nécessite forcément une dissémination temporelle. Une des conséquences pourrait être un moindre recours à la pratique de la ponction lombaire en gardant toutefois à l’esprit l’importance que peut avoir une analyse positive du LCS dans le diagnostic différentiel de la maladie. La reconnaissance des SEP asymptomatiques doit beaucoup au travail mené sur l’histoire naturelle des RIS par Christine Lebrun-Frénay (Nice) et le consortium international. Les résultats des études démontrant l’intérêt des traitements d’efficacité intermédiaire dans ces formes vont poser la question de l’indication des traitements de haute efficacité chez certains patients sélectionnés sur des critères IRM de mauvais pronostic et également de l’intérêt du dépistage chez les apparentés au 1er degré, qui est une question récurrente de la part des patients. L’unification des critères des formes progressives et des formes rémittentes, au-delà d’une simplification bienvenue, témoigne de la reconnaissance de l’unicité physiopathologique de la SEP. Ces critères doivent principalement s’utiliser chez des patients ayant présenté un événement évocateur d’une pathologie inflammatoire, même si l’on constate que les biomarqueurs prennent une place de plus en plus importante dans le diagnostic de la SEP, à l’instar de ce qui est en développement dans d’autres pathologies comme les maladies de Parkinson ou d’Alzheimer. Pour la SEP, il s’agit principalement de biomarqueurs d’imagerie avec le signe de la veine centrale ou les anneaux paramagnétiques. Leur place exacte chez des patients au début de la maladie, ayant peu de lésions, reste néanmoins à préciser en pratique clinique courante. Les critères 2024 posent comme préalable que le diagnostic de SEP est un diagnostic d’exclusion, ce qui correspond assez peu à la façon dont nous abordons l’enquête diagnostique chez un patient suspect de SEP et qui pose la question de l’étendue des investigations devant être pratiquées. À ce titre, les critères 2024 proposent des garde-fous dans certaines populations où la prévalence des diagnostics différentiels est importante comme chez l’enfant, avec la MOGAD, ou chez le sujet plus âgé ayant des comorbidités vasculaires, pour lesquels il faut être particulièrement vigilant. Ils rappellent également l’importance de reconsidérer régulièrement le cadre diagnostic chez les patients présentant des atypies. Enfin, cette évolution des critères, en renforçant l’exigence de précision dans l’analyse des événements cliniques et des aspects des images en IRM afin de garder une forte spécificité dans le diagnostic, met en avant l’importance du rôle de l’expertise des cliniciens confrontés à ces pathologies.