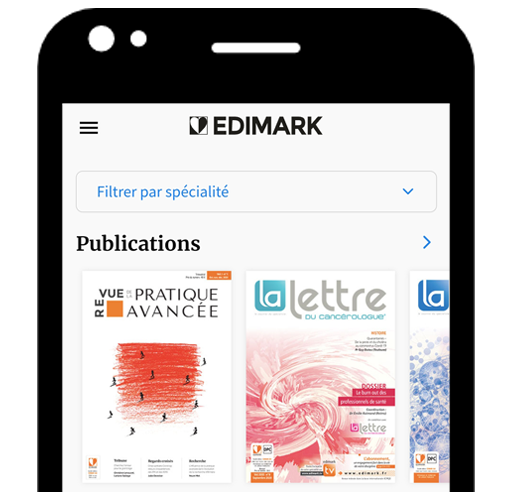Vers la fin des années 1990, un patient qui avait été cheminot au temps de la locomotive à vapeur et qui venait faire le point en consultation sur des images d'anthracose se souvenait du nombre de tonnes de charbon qu'il pelletait entre Montauban et Bordeaux : 8 tonnes pour “descendre” à Bordeaux, dont l'altitude est voisine de celle de la mer, et 10 tonnes pour “remonter” à Montauban, à peine 100 mètres plus haut et 200 km plus loin. Un rapide calcul montre qu'une déclivité moyenne inférieure à un millième de degré entre ces 2 villes se traduisait par une différence aussi énorme que 2 tonnes de charbon… Les amateurs de glisse hivernale connaissent eux aussi les conséquences majeures du “au degré près” : depuis plusieurs années, dans les Alpes, les hivers voient se succéder à haute altitude des chutes de neige et des chutes de pluie à cause d'une température oscillant de part et d'autre du point magique qui rend la montagne soit blanche, soit grise. Le grand équilibre du monde est subtil.
En arrivant à Barcelone pour le congrès de l'European Respiratory Society (ERS) qui s'est tenu au début du mois de septembre dernier, le bruit courait que la climatisation des salles serait réglée à une température à peine plus élevée qu'attendue, eu égard aux préoccupations écologiques du moment et au prix de l'énergie – et ce, dans un pays, l'Espagne, où la part des énergies renouvelables est d'environ 20 % de la consommation totale, soit un peu plus que la France et 3 fois moins que la Suède. Proposer aux congressistes d'évoluer pendant 3 jours dans des bâtiments soumis à une température inhabituellement élevée les a non seulement invités à sacrifier aux coutumes locales en utilisant un éventail pour se rafraîchir, mais aussi à réfléchir aux enjeux de ces quelques degrés en plus.
Nombreuses sont les sociétés savantes – dont l'ERS – qui ont alerté depuis quelques lustres sur les conséquences sanitaires probables du réchauffement climatique, en annonçant notamment qu'il y aurait sur la santé respiratoire un effet direct des vagues de chaleur, de la pollution atmosphérique liée aux incendies et aux aérosols, mais aussi des effets liés à une plus grande distribution spatiale et temporelle d'allergènes et de vecteurs de maladies infectieuses [1]. Les années que nous venons de vivre n'ont hélas pas démenti ces prévisions. Néanmoins, le modèle de communication médicale qui prévaut actuellement, dans les congrès ou ailleurs, vise bien davantage à présenter des solutions innovantes pour le diagnostic et le traitement des maladies respiratoires qu'à aborder toute la complexité de leur prévention. Comme le soulignait dans une récente tribune du Monde le professeur de santé publique Bruno Falissard, alors que l'heure est à la critique de notre modèle de société du “toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus de technologie”, la médecine a échappé à cette critique et elle en est même un contre-exemple patent [2]. S'il ne s'agit pas ici de nier les progrès accomplis ces dernières années dans tel ou tel domaine du diagnostic et du soin (en particulier dans le domaine des maladies respiratoires), ni le bénéfice que certains patients peuvent en tirer, l'idée est en revanche de se poser quelques questions à la fois sur leur pertinence à l'échelle d'une société et sur leur champ d'utilisation. Regardons en arrière et prenons l'exemple d'une découverte aussi cruciale que la vaccination : elle a entre autres permis, au tournant des années 1940, de diminuer de façon incroyable la mortalité infantile. Néanmoins, l'ethnologue Germaine Tillion rappelait volontiers à quel point son usage sans accompagnement – en particulier par l'instruction – avait, dès le milieu du XXe siècle, contribué à agrandir abruptement les familles, en avait détruit les structures ancestrales et avait entraîné un exode rural amenant à une urbanisation anarchique et brutale [3]. Sans aller jusqu'à sous‑entendre que toute innovation porte en elle le germe d'une catastrophe, il est indispensable de rappeler que la dépense courante de santé au sens international (DCSi) représentait en 2021, en France, un peu plus de 12 % du produit intérieur brut (PIB) [4]. Il s'agit de l'un des pourcentages les plus élevés parmi les pays membres de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les moyens financiers alloués à la santé n'étant pas illimités, une utilisation inconsidérée de technologies et de traitements de plus en plus onéreux ne pourra se faire qu'au détriment du temps dédié au soin et à la prévention, ce temps singulier de la relation entre les soignants et les patients, qui fait le sens de nos métiers et dont la disparition (ou en tout cas la perception de la disparition) contribue largement à la crise actuelle de notre système de santé. Or, ce temps du dialogue et de l'examen clinique, cette médecine volontiers présentée comme “dépassée”, permet non seulement d'établir des diagnostics sans avoir recours à des technologies “dernier cri” (et donc à moindre coût), mais aussi d'aborder toutes les questions fondamentales du maintien en (bonne) santé. Prévenir la survenue d'une maladie, c'est aussi limiter le potentiel recours à des traitements innovants mais très coûteux. Notre vision même du champ d'utilisation de ces traitements innovants devrait nous questionner. Il n'est pas totalement certain que la façon dont nous sont présentées toutes les avancées thérapeutiques nous laisse totalement libres de les utiliser ou pas. En d'autres termes, il est fort possible que le paradigme qui s'applique à la promotion publicitaire et à la commercialisation de produits de consommation courante s'applique aussi aux innovations médicales, et que toute la promotion dont ces innovations médicales font l'objet ne nous les fasse apparaître comme indispensables.
Au début des années 1970, le chanteur franco-néo-zélandais Graeme Allwright entonnait la Ballade de la désescalade. Cinquante ans plus tard, peut-on croire avec lui que “pour sortir de la panade, des frites et des grillades, un peu moins chaque jour et c'est gagné” ? Ou bien au contraire, pour paraphraser des propos plus récents, une certaine forme de décroissance ne doit-elle être regardée que comme “un retour à la lampe à huile” ? On peut aborder le problème différemment. Admettons que, pour résoudre un problème de santé donné, il nous soit nécessaire d'innover. Une réduction du raisonnement consiste à considérer que toute innovation fait nécessairement intervenir une technologie. Or, une innovation peut aussi être sociale, politique, économique… Vagues de chaleur, pollution atmosphérique et domestique, tabagisme, exposition accrue à des allergènes et à des vecteurs de maladies infectieuses : imaginer résoudre toutes les conséquences respiratoires de ces phénomènes par des “traitements”, aussi sophistiqués soient-ils, donne le vertige. Il est sans doute urgent que notre communauté de soignants regarde le problème dans toute sa complexité et pèse de tout son poids pour contribuer à infléchir (de quelques degrés ?) la trajectoire sur laquelle s'inscrivent les innovations en termes de santé respiratoire. Innover pour prévenir est sans doute aussi passionnant et élégant qu'innover pour guérir.