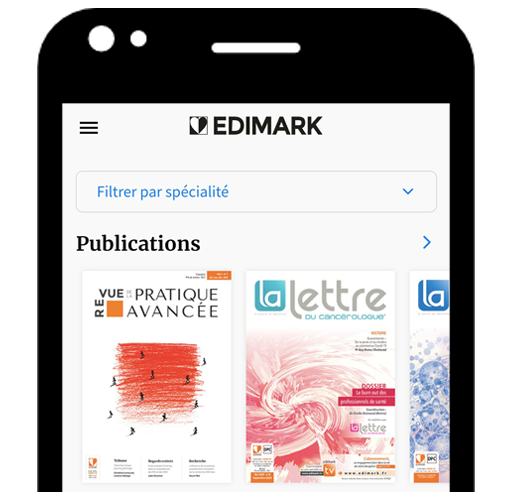Parmi les pathologies respiratoires chroniques, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) se distingue par son hétérogénéité, dont les facettes sont nombreuses. En effet, bien que l’existence d’un trouble ventilatoire obstructif persistant soit un point commun à l’ensemble des patients, les symptômes (dyspnée, toux et expectorations) et leur intensité peuvent être très variables d’un patient à l’autre. D’autres éléments, tels que la distension, l’emphysème ou les anomalies de l’hématose, peuvent également différer considérablement selon les individus. De plus, bien que la survenue d’une BPCO soit presque toujours déterminée par une ou plusieurs expositions (au 1er rang desquelles figure le tabagisme), plusieurs trajectoires de santé sont susceptibles de mener à la maladie, cette dernière pouvant parfois coexister avec un asthme ou des dilatations des bronches. Ensuite, de nombreuses comorbidités (maladies cardiovasculaires, anxiété ou dépression, troubles nutritionnels, etc.) peuvent s’associer de façon variable à la BPCO et avoir une incidence sur son évolution. En outre, puisqu’il s’agit d’une pathologie dont l’aggravation est progressive en l’absence d’une prise en charge appropriée, la sévérité de la BPCO dépend pour partie du moment auquel elle est diagnostiquée et traitée, et le fait qu’elle puisse, au moins en théorie, être identifiée à des stades différents selon les patients accentue encore son hétérogénéité. Enfin, faut-il rappeler que certains patients vont emprunter un chemin semé d’exacerbations et d’autres pas ?
Ainsi brossé, le tableau de la BPCO n’invite pas forcément à envisager le contrôle de la maladie − dont une définition uniforme conduirait à négliger son hétérogénéité − pour tous les patients, à l’instar du paradigme qui prévaut depuis des années dans le traitement de l’asthme.
Contrôler la BPCO est pourtant une idée qui émerge depuis une dizaine d’années. Le concept de contrôle consiste à concilier une dimension “transversale” de la prise en charge de la maladie et de ses comorbidités (diagnostic et optimisation thérapeutique) et une dimension “longitudinale” (stabilisation de l’état optimal obtenu) [1]. Atteindre le contrôle de la BPCO implique nécessairement de tenir compte de sa complexité et de son hétérogénéité. Néanmoins, pour tous les patients, l’objectif du contrôle est le même. Dans sa dimension “transversale”, une fois la BPCO dûment diagnostiquée, il consiste à identifier, parmi tous les éléments qui ont un impact sur l’état de santé du patient, ceux qui sont accessibles à une prise en charge, selon le concept de la “caractéristique traitable” ; la liste est longue et inclut la prise en charge du tabagisme, de la dépression, de l’expectoration, de l’alimentation, de l’activité physique, etc. Cette prise en charge “à la carte” implique sans doute une sorte de “contrat” passé avec chaque patient, qui doit tenir compte des attentes de ce dernier, de la vision des soignants quant aux objectifs atteignables, et des ressources thérapeutiques disponibles au moment où ce “contrat” est approuvé. Dans sa dimension “longitudinale”, le contrôle suppose d’identifier les éléments pouvant déstabiliser la situation, tels que les exacerbations récurrentes, une reprise du tabagisme ou la survenue d’une comorbidité.
Mettre en avant le contrôle plutôt que les thérapeutiques nouvelles peut paraître naïf, mais il est important de faire avancer les 2 visions ensemble – l’exemple des progrès accomplis dans la prise en charge de l’asthme depuis 3 décennies en est sans doute une bonne illustration. Dans le cas de la BPCO, parler de contrôle impose également de prendre de la hauteur quant aux objectifs, pour une prise en charge holistique commençant par une identification la plus précoce et la plus appropriée possible de la maladie.