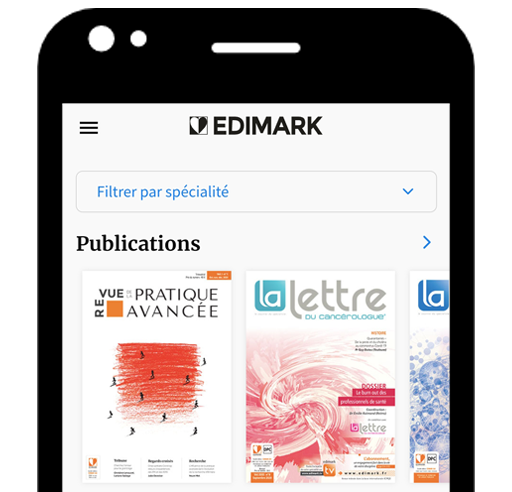Mise au point
Maladie des exostoses multiples : diagnostic et prise en charge
- Maladie génétique autosomique dominante avec une prévalence de 1/50 000, caractérisée par le développement d'exostoses osseuses, principalement au niveau des métaphyses des os longs.
- Mutation inhibitrice des gènes EXT (EXT1 ou EXT2) représentant 90 % des cas en France.
- Rôle central du métabolisme des héparanes sulfate.
- Nécessité d'une cartographie initiale des exostoses par imagerie corps entier, notamment chez le jeune adulte.
- Suivi clinique régulier nécessaire avec imagerie centrée (IRM) en cas de symptomatologie sur exostose connue, devant le risque potentiel de transformation sarcomateuse.
La maladie des exostoses multiples (MEM) est une maladie génétique à transmission autosomique dominante, de prévalence proche de 1 individu sur 50 000 avec un sex-ratio de 1 [1]. Elle est caractérisée par le développement de protubérances osseuses (exostoses), situées principalement à proximité de la métaphyse des os longs, recouvertes d'une couche cartilagineuse superficielle, régressant avec l'âge, en parallèle de la croissance [2] (figure 1). Les connaissances de la physiopathologie sous-tendant le développement de la MEM ont récemment évolué, permettant une meilleure compréhension et surtout…
L’accès à la totalité de l’article est protégé
Vous possédez déjà un compte Edimark ?
Merci de saisir votre e-mail et votre mot de passe.
Identifiant ou mot de passe oublié
Besoin d'aide ?
Créer un compte
Liens d'intérêt
F. Robin et P. Guggenbuhl déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts en relation avec cet article.
Identifiant / Mot de passe oublié
Vous avez oublié votre mot de passe ?
Vous avez oublié votre identifiant ?
Consultez notre FAQ sur les problèmes de connexion ou contactez-nous.Vous ne possédez pas de compte Edimark ?
Inscrivez-vous gratuitementPour accéder aux contenus publiés sur Edimark.fr vous devez posséder un compte et vous identifier au moyen d’un email et d’un mot de passe. L’email est celui que vous avez renseigné lors de votre inscription ou de votre abonnement à l’une de nos publications. Si toutefois vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, veuillez nous contacter en cliquant ici.