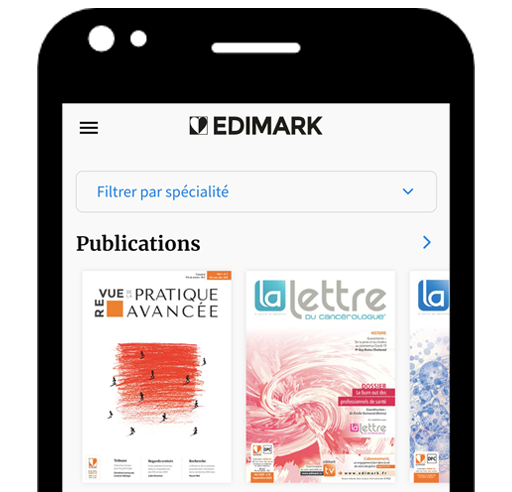La pratique quotidienne en rhumatologie est aujourd’hui marquée par des avancées thérapeutiques majeures, notamment grâce aux traitements ciblés. Cependant, certaines situations cliniques demeurent complexes à traiter ou à gérer. Ce dossier explore, à travers plusieurs articles, la difficulté de traiter des pathologies telles que la polyarthrite rhumatoïde (PR), la spondyloarthrite axiale, le rhumatisme psoriasique, le lupus systémique, la pseudopolyarthrite rhizomélique (PPR), la goutte et l’ostéoporose. Il met en évidence l’importance d’une approche globale et individualisée dans la prise en charge de ces patients.
- Dans le premier article dédié à la PR, Juliette Drouet et Bruno Fautrel soulignent que, malgré l’amélioration du pronostic au cours des dernières décennies, une proportion non négligeable de patients demeure symptomatique. Il paraît essentiel de distinguer les PR réfractaires avec signes inflammatoires persistants (PIRRA) des formes symptomatiques sans signe inflammatoire (NIRRA). Cette distinction permet d’affiner l’évaluation de l’activité inflammatoire, souvent compliquée par la présence de comorbidités et par les limites des outils de mesure actuels. En définitive, la prise en charge de la PR difficile à traiter requiert une stratégie adaptée à chaque profil, alliant précision diagnostique et personnalisation thérapeutique, sans oublier les approches non médicamenteuses.
- Pour les spondyloarthrites, Daniel Wendling rappelle que la caractérisation de ces maladies comme étant difficiles à gérer intervient après l’échec d’au moins 2 traitements ciblés reposant sur des mécanismes d’action différents. La présence d’une activité inflammatoire élevée reste indispensable pour qualifier la maladie de “difficile à traiter ou à prendre en charge”. Par ailleurs, il convient d’analyser finement les causes de l’échec thérapeutique, qu’il s’agisse de l’observance, de l’impact des comorbidités ou de manifestations extra-articulaires. Ces échecs soulignent l’importance d’un suivi régulier et d’une réévaluation constante des stratégies mises en œuvre.
- Dans la mise au point sur le lupus systémique, avec l’aide d’Alexis Mathian, je propose d’adapter les concepts développés pour la PR difficile à traiter en intégrant des critères cliniques, biologiques et thérapeutiques spécifiques au lupus systémique. La gestion des corticoïdes, au cœur de cette problématique, nécessite un équilibre subtil entre contrôle de la maladie et limitation des complications associées. De plus, l’intérêt croissant pour les biomarqueurs et pour la mesure de l’adhésion thérapeutique ouvre la voie à des approches innovantes, comme l’évaluation de l’hydroxychloroquinémie, afin de prévenir des escalades thérapeutiques inutiles.
- Valérie Devauchelle-Pensec aborde quant à elle la PPR sous l’angle du sevrage des corticoïdes. L’absence de réponse initiale ou la persistance d’une corticodépendance doit alerter sur un diagnostic à reconsidérer ou sur la nécessité de recourir à des agents épargneurs, tels que les inhibiteurs de l’interleukine 6, les inhibiteurs de JAK ou encore le rituximab dans certains cas.
- L’article de Tristan Pascart aborde le double visage du rhumatisme à cristaux de pyrophosphate de calcium. Si les arthrites aiguës se traitent généralement sans difficulté, les formes chroniques représentent un réel défi, notamment en raison de difficultés diagnostiques. La réponse à la colchicine n’étant effective que dans environ 50 % des cas, le recours à d’autres traitements – tels l’anakinra dans certains cas aigus ou, pour les formes réfractaires, d’autres traitements ciblant l’interleukine 1 ou 6, sans oublier le méthotrexate – vient enrichir l’arsenal thérapeutique, tout en rappelant la nécessité d’une prise en charge précoce et adaptée.
- Concernant l’ostéoporose, Marie-Eva Pickering propose une réflexion sur 8 situations spécifiques dans lesquelles sa prévention ou son traitement se complexifient : insuffisance rénale sévère, corticothérapie prolongée, état buccodentaire, anorexie mentale, chirurgie bariatrique, grossesse, pathologie cancéreuse et échec thérapeutique. Cette approche thématique rappelle combien il est crucial de fédérer l’expertise de différents spécialistes pour élaborer des recommandations consensuelles et renforcer l’alliance patient‑professionnel de santé.
Ce dossier met en lumière la dualité de notre pratique : l’émergence de thérapies innovantes, qui ont transformé le pronostic de nombreuses pathologies rhumatologiques, et la persistance de formes réfractaires, qui nous obligent à repenser nos approches diagnostiques et thérapeutiques. L’hétérogénéité des mécanismes impliqués, la variabilité des réponses individuelles et les contraintes posées par les comorbidités rappellent que le traitement des pathologies difficiles ne peut être réduit à une simple question d’adhésion à un algorithme standardisé. Il s’agit avant tout d’un processus itératif, où l’interdisciplinarité, la multidisciplinarité et la personnalisation des stratégies de prise en charge demeurent essentielles.
À l’heure où la médecine de précision prend tout son sens, il est nécessaire de favoriser ces approches collaboratives. L’avenir de la prise en charge des pathologies difficiles à traiter repose sur une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents, le développement de biomarqueurs fiables et l’élaboration de recommandations consensuelles adaptées aux spécificités de chaque patient. À l’instar de La Lettre du Rhumatologue, le Lancet Rheumatology vient de publier une revue sur le concept de pathologies difficiles à traiter en rhumatologie , qui propose cette approche holistique avec plusieurs éléments à appréhender :
- réévaluation du diagnostic, par exemple avec l’aide de radiologues expérimentés dans la spondyloarthrite axiale ;
- collaboration avec d’autres spécialités, par exemple avec les pneumologues dans la PR, les gastroentérologues et dermatologues dans les spondyloarthrites, les dentistes dans l’ostéoporose ;
- éducation thérapeutique et amélioration de l’adhérence au traitement ;
- options non médicamenteuses, pour une prise en charge holistique ;
- prise en charge des comorbidités, notamment l’intoxication tabagique et l’obésité ;
- prise en considération des facteurs psychosociaux.
Nous espérons que la lecture de ce numéro répondra à vos attentes et vous aidera à gérer vos patients considérés comme difficiles à traiter.