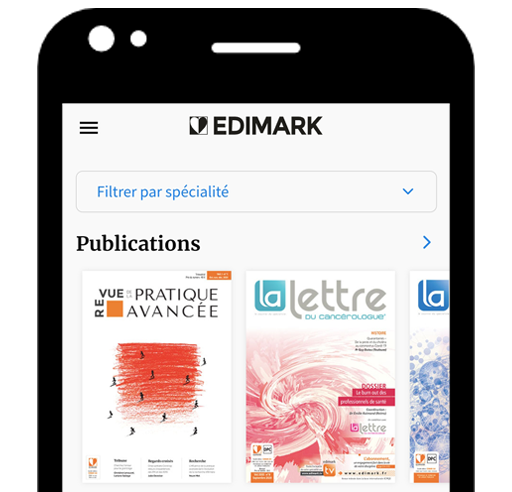Spécificité des cancers chez les patients immunodéprimés
- L'immunodépression, notamment chez les patients transplantés (d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques) ou en cas d'infection par le VIH, est associée à une augmentation de l'incidence de nombreux cancers, responsable d'une morbidité et d'une mortalité importantes dans ces populations. L'épidémiologie et la présentation clinique de ces cancers sont différentes de celles de la population générale, avec un rôle important d'agents infectieux (notamment viraux) dans l'oncogenèse, un diagnostic parfois plus tardif, une pathologie plus agressive et un pronostic souvent plus péjoratif. En l'absence de recommandations précises sur le plan thérapeutique, hormis les lymphoproliférations postgreffe, l'attention doit être portée sur les comorbidités et les interactions médicamenteuses potentielles, en particulier via le cytochrome P450, nécessitant le recours à une prise en charge multidisciplinaire avec une réunion de concertation comme celles des groupes CANCERVIH et k-virogref en France. L'objectif de cette revue est de présenter une actualité scientifique concernant l'épidémiologie des cancers associés à l'immunodépression, leurs causes possibles et la spécificité de leur prise en charge.
L’accès à la totalité de l’article est protégé
Vous possédez déjà un compte Edimark ?
Merci de saisir votre e-mail et votre mot de passe.
Identifiant ou mot de passe oublié
Besoin d'aide ?
Créer un compte
Liens d'intérêt
A. Gobert, M. Veyri et N. Balegroune déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
V. Leblond et J.P. Spano déclarent avoir des liens d’intérêts avec Roche, MSD, Gilead, Novartis, Lilly, PFO et AstraZeneca.
S. Choquet déclare avoir des liens d’intérêts avec Roche, Biogaran, Sandoz et Atara.
Identifiant / Mot de passe oublié
Vous avez oublié votre mot de passe ?
Vous avez oublié votre identifiant ?
Consultez notre FAQ sur les problèmes de connexion ou contactez-nous.Vous ne possédez pas de compte Edimark ?
Inscrivez-vous gratuitementPour accéder aux contenus publiés sur Edimark.fr vous devez posséder un compte et vous identifier au moyen d’un email et d’un mot de passe. L’email est celui que vous avez renseigné lors de votre inscription ou de votre abonnement à l’une de nos publications. Si toutefois vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, veuillez nous contacter en cliquant ici.